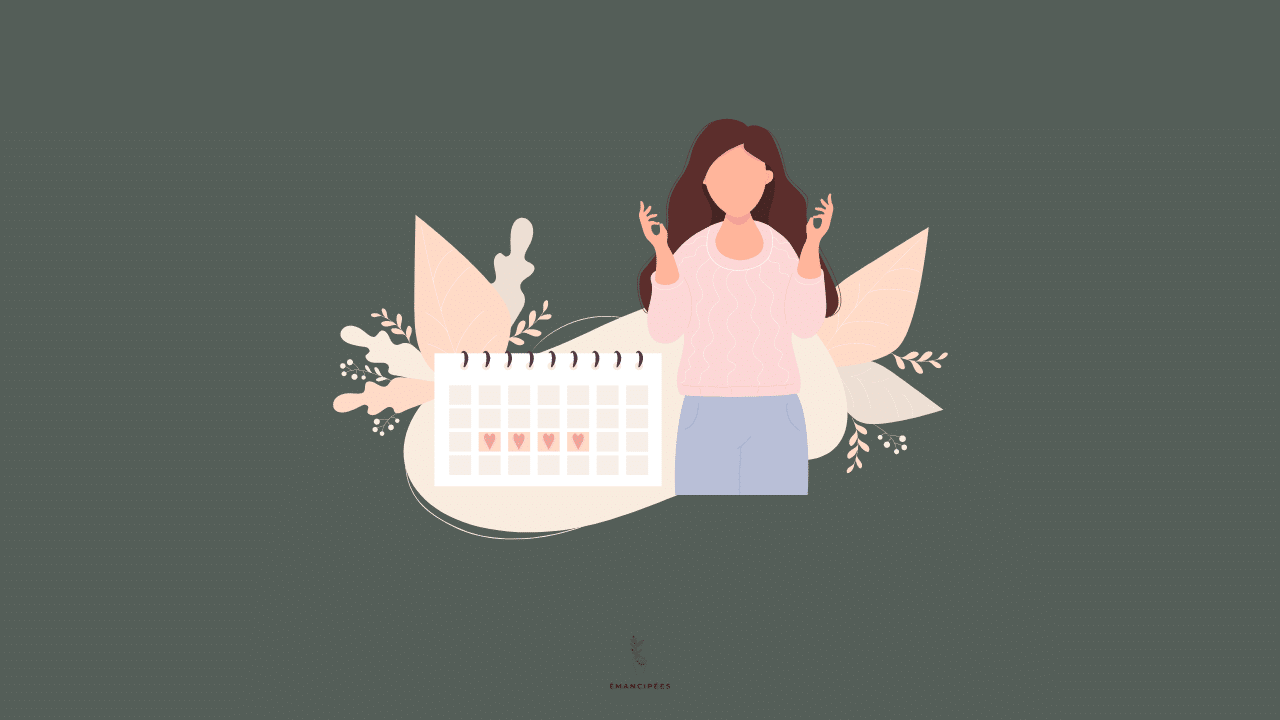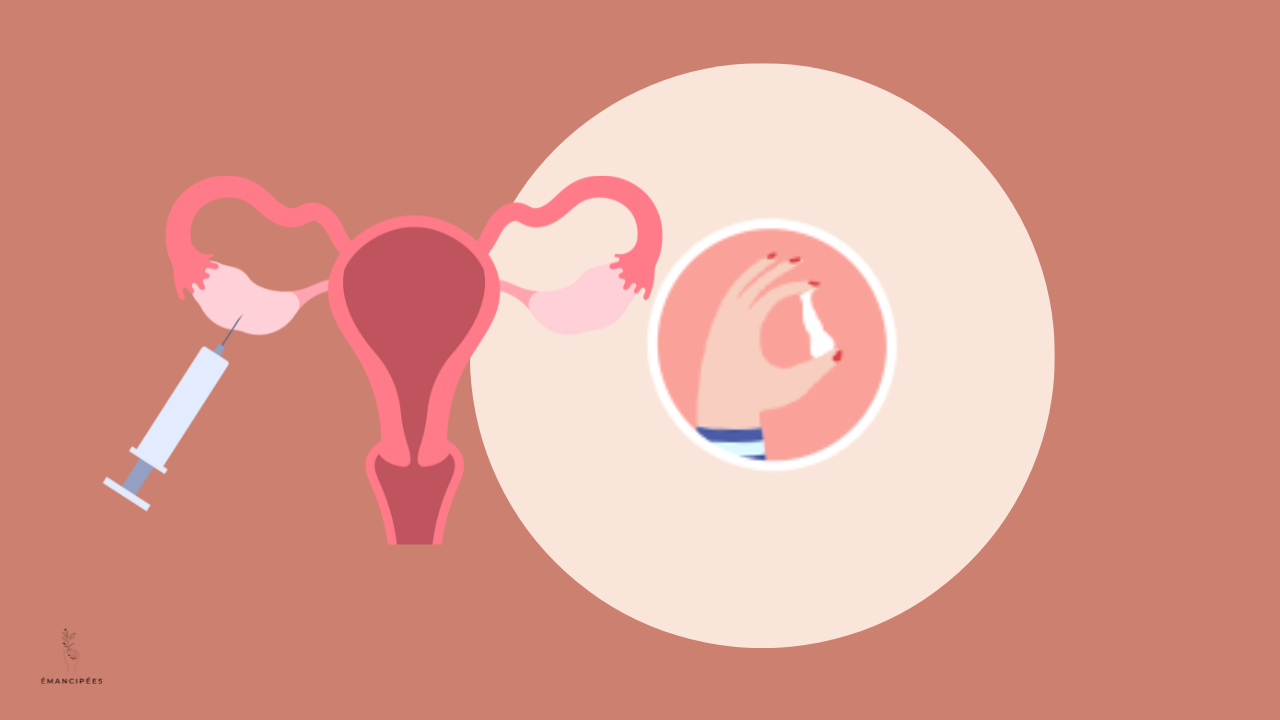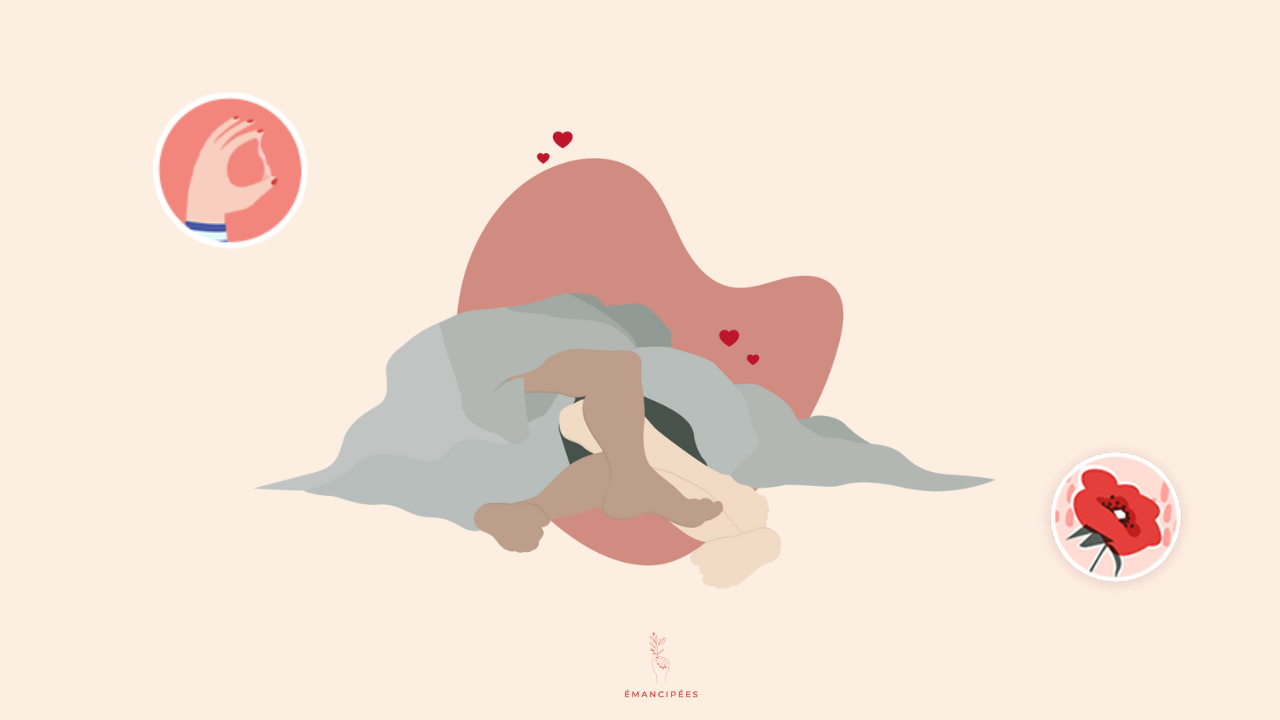Les idées clés
Imaginez la scène : vous avez décidé de vous préparer un bon petit plat et pour ce faire, vous avez choisi une recette plutôt saine et équilibrée, vous avez sélectionné des produits les plus clean possibles chez votre petit producteur bio et pris le temps d’éplucher et couper tous ces ingrédients… avant de les faire cuire dans une mare de substances toxiques. C’est ballot, n’est-ce-pas ? Et pourtant, c’est, à peu de chose près, ce que l’on fait tous au quotidien !
En effet, si les aliments que l’on choisit de manger sont primordiaux, notre manière de les cuire l’est tout autant. Or, la plupart des poêles proposées sur le marché contiennent des PFAS, qui sont des molécules très problématiques pour notre santé, et notamment pour notre santé féminine et hormonale.
Quelles sont ces molécules qui posent problème ? Quels produits en contiennent et surtout LA question ultime : comment être sûre de bien choisir quand on a besoin d’une poêle 100% safe, et quels sont les critères à respecter pour éviter tous les inconvénients des PFAS ? Bref quelle poêle choisir pour la santé ?
Dans cet article, on vous explique quels matériaux sont à éviter, quels sont au contraire ceux à privilégier et on vous donne même une petite liste de marques qui proposent des poêles tout à fait convenables, pour que ce soit le moins prise de tête possible pour vous 🙂

Pourquoi éviter les PFAS ?
Que sont les PFAS ?
Les PFAS sont des molécules combinant carbone et fluor, que l’on appelle aussi des substances per- et polyfluoroalkylées. Elles sont très utilisées pour leurs propriétés anti-adhésives et imperméabilisantes, notamment. Parmi les inconvénients majeurs des PFAS : ils sont considérés comme des polluants éternels, du fait de la combinaison quasiment indestructible du carbone et du fluor. Cette combinaison a également des répercussions sur la santé humaine.
Les PFAS sont une grande famille, qui compte à ce jour 14 000 molécules : en effet, à chaque fois que l’une de ces molécules est étudiée et que les recherches montrent qu’elle est potentiellement dangereuse, les industriels créent de nouvelles molécules pour éviter les interdictions, en modifiant très légèrement leur composition. Tous les PFAS n’ont pas encore été étudiés, mais deux d’entre eux sont déjà interdits en Europe : les PFOS (sulfonate de perfluorooctane), interdits depuis 2009 et les PFOA (acide perfluorooctanoïque), depuis 2020.
Toutefois, les scientifiques recommandent de considérer tous les PFAS de la même manière, car selon eux, quand des produits chimiques ont la même structure moléculaire, des propriétés environnementales et des risques biologiques identiques, il convient de les gérer comme une classe de produits à part entière, pour limiter les risques humains et environnementaux. En clair, si un PFAS est dangereux, on peut considérer qu’ils le sont tous !
Par ailleurs, bien qu’interdits, on retrouve encore des traces de PFOS et de PFOA dans l’environnement, dans les sols et les cours d’eau, mais aussi dans l’organisme des plantes et animaux. D’ailleurs, l’une des principales sources de PFAS est l’eau potable (mais aussi l’alimentation). L’étude Esteban, mise à jour en 2020, estime que « Le PFOA et le PFOS, (…) ont été quantifiés à 100 % aussi bien chez les enfants que chez les adultes« .
Donc en gros : tous les PFAS ne sont pas interdits, et ceux qui le sont ont de toute façon laissé des traces qui vont nous suivre pendant des années…

Quels sont les impacts des PFAS sur la santé ?
Les PFAS sont cancérigènes
Le CIRC (Centre International de recherche sur le Cancer) a publié une étude en novembre 2023 considérant que les PFOA sont des substances chimiques cancérogènes pour l’humain (au même titre que l’amiante) et que les PFOS représentent un risque possible de cancer.
LES PFAS sont des perturbateurs endocriniens
Les PFAS sont potentiellement des perturbateurs endocriniens, en plus d’être cancérigènes.
Mais qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? Il s’agit d’une substance qui va soit :
Mimer l’action d’une hormone que l’on produit nous-même de manière endogène
Brouiller le message entre notre cerveau et nos hormones.
C’est la raison pour laquelle, selon l’ANSES, les PFAS sont mis en cause en raison de leurs « effets sur la fertilité et le développement du fœtus« , ainsi que sur les hormones thyroïdiennes.
Les perturbateurs endocriniens viennent complètement perturber le cycle menstruel et nos hormones féminines, puisque le dialogue entre notre cerveau, nos ovaires, et éventuellement notre thyroïde, nos surrénales (qui sécrètent aussi les hormones du stress) et notre pancréas (qui sécrète l’insuline et gère notre glycémie) est totalement désorganisé. Cela peut poser, à terme, des problèmes de cycle menstruel (comme le syndrome prémenstruel ou le SOPK, par exemple), voire des troubles de la fertilité. C’est la raison pour laquelle on vous en parle beaucoup dans le Fertility Club, par exemple !

Dans quels objets du quotidien retrouve-t-on des PFAS ?
Le souci avec les PFAS, c’est qu’on en retrouve un peu partout : dans les ustensiles de cuisine, les textiles imperméabilisants, certains cosmétiques et les emballages alimentaires, entre autres !
En mai 2024, une loi a interdit les PFAS dans un grand nombre de produits de consommation, ce qui est une excellente nouvelle ! Toutefois, une famille de produits est exemptée : les ustensiles de cuisine, alors que les poêles et casseroles anti adhésives peuvent contenir des PFAS, que ce sont des choses que l’on utilise tous les jours et que les aliments sont en contact direct avec le revêtements et peuvent donc en contenir des traces.
Mais pas de panique ! On va donc vous expliquer comment bien choisir vos poêles et autres ustensiles, pour éviter de nuire à votre cycle et à votre fertilité 🙂

Une règle d’or : éviter le Téflon
On a toutes et tous dans nos placards des poêles en Téflon, puisque ce matériau présente des avantages non négligeables, dont celui de ne pas du tout accrocher. Or, le souci réside justement dans ce revêtement anti-adhésif !
Il était auparavant réalisé avec des PFOA : après leur interdiction en 2020, les industriels ont donc décidé de créer une nouvelle molécule aux mêmes propriétés pour leurs revêtements : les PFTE. Sauf que ! Les PFTE, une nouvelle famille de PFAS donc, présentés comme une alternative sans danger aux PFOA, ne sont en réalité pas forcément si sûrs : une étude explique qu’on ne peut pas, à ce jour, affirmer que les PTFE n’entrent pas dans les cellules humaines.
De plus, une enquête du magazine 60 millions de consommateurs démontre que les poêles avec un revêtement PFTE peuvent aussi contenir des PFAS, un peu par « contamination croisée » sur les chaînes de production.
Donc, en clair : si vous voyez une poêle avec un revêtement adhésif en Téflon sans PFOA, mais avec des PFTE (ou une autre famille de PFAS), reposez-la tranquillement sur le rayon de votre magasin !

Poêles sans PFAS : les fausses bonnes idées
OK, maintenant qu’on sait qu’il faut éviter le Téflon, on peut partir sur n’importe quelle poêle sans Téflon ? Non, pas tout à fait ! En effet, les industriels ne manquent pas d’imagination et peuvent parfois nous proposer des alternatives avec des matériaux qui semblent tout à fait sûrs sur le papier : mais quand on creuse un peu, on se rend compte que le bât blesse :s
Céramique
Les poêles en céramique sont souvent présentées comme une alternative saine et naturelle au Téflon : pourtant, les poêles en céramique peuvent aussi contenir des PFAS, même si elles en contiennent moins que les poêles avec revêtement adhésif.
Par ailleurs, leur revêtement a une durée de vie réduite et elles finissent par accrocher. Dernière chose et non des moindres : on ne connaît pas toujours dans les détails la composition de l’alliage utilisé (souvent à base de silice). Pour couronner le tout, elles peuvent aussi contenir des nanoparticules ! Bref, c’est un peu une fausse bonne idée.
Aluminium
En soi, les poêles et casseroles en aluminium sans revêtement ne contiennent pas de PFAS. Toutefois, il est possible que des particules d’aluminium migrent dans les aliments, surtout avec des aliments acides comme la tomate. Or, une concentration trop élevée d’aluminium dans le sang aurait un lien avec un risque accru de maladies dégénératives ! Certes, les quantités d’aluminium ingérées par repas sont infimes, mais dans le doute, autant éviter 😉
Pierre
Là encore, la pierre fait partie des matériaux présentés comme sûrs aux consommateurs, car naturels : sauf qu’il semblerait que les poêles en pierre ne soient pas, là non plus, exemptes de PFAS, notamment si elles disposent d’un revêtement anti adhésif.
Par ailleurs, les poêles en pierre ne sont souvent pas complètement en pierre, et leur composition exacte reste un peu mystérieuse : il s’agit généralement d’une matière combinant granit et, potentiellement, des PFAS.
GEN-X
Que dire du Gen-X, aka le nouveau Téflon ? Et bien, il s’agit ni plus ni moins d’un nouveau PFAS et il reste sur la liste noire des « substances extrêmement préoccupantes« selon l’Agence Européenne des Produits Chimiques. Le GEN-X a donc les mêmes « inconvénients » que les autres PFAS pour nous autres consommateurs, et est un matériau à éviter absolument !

Quels matériaux choisir pour une cuisson saine et quelle poêle choisir pour la santé ?
En lisant ce qui précède, vous avez peut-être l’impression qu’il n’y a aucune poêle non toxique sur le marché, qu’aucun matériau n’est secure, mais on tient quand même à vous rassurer : si si, certaines poêles ne présentent pas de danger pour votre santé ! La fonte, l’inox et le cuivre sont des matériaux vers lesquels vous pouvez vous tourner 🙂
Fonte
Les poêles en fonte de nos grands-mères sont généralement exemptes de PFAS (sauf, encore une fois, si elles disposent d’un revêtement anti adhésif). La fonte est un matériau composé de fer et de carbone, qui permet de très bien conduire et garder la chaleur, qualités que l’on attend généralement d’une poêle. Elles ont également une durée de vie infinie ! Toutefois, elles présentent 3 inconvénients : elles sont lourdes, elles accrochent et elles ont un certain prix.
Si on ne peut pas vraiment vous aider à résoudre le premier point (on ne va pas forcément vous recommander de muscler vos bras à outrance pour pouvoir les porter sans souci ^^), le deuxième point, celui de « l’accroche » n’est pas tout à fait vrai. Certes, les poêles en fonte ont la réputation d’accrocher les aliments, notamment les viandes, les poissons, les oeufs, les pommes de terre et les légumes. Mais il y a une petite astuce : le culottage avant la première utilisation !
Le culottage consiste en fait à créer un revêtement adhésif naturellement dans votre poêle en fonte 🙂 Pour ce faire, voici les étapes à suivre :
Enduire votre poêle d’une fine couche d’huile végétale neutre (à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur), avec du papier absorbant
Puis, mettre votre poêle en fonte ou votre casserole au four, à puissance maximale pendant une heure : en chauffant, la fonte va absorber l’huile et créer une matière anti-adhésive.
Au bout d’une heure, laissez refroidir votre poêle et votre casserole et renouvelez l’opération encore 1 fois ou 2 !
Cette méthode est donnée à titre indicatif : jetez un oeil à la notice fournie par le fabricant, qui vous expliquera comment culotter votre poêle ou casserole 😉
Bon point : le culottage continue de se faire avec le temps, ce qui signifie que vos casseroles et poêles en fonte accrocheront de moins en moins 🙂 Ce sont aussi des ustensiles de cuisine que vous pourrez garder pendant longtemps ! La plupart du temps, par facilité d’utilisation, les marques ont déjà pré-culotté les poêles et casseroles en fonte qu’ils vous proposent 😉
Pour la cuisson, si la casserole ou la poêle a été bien culottée, vous n’aurez pas besoin d’ajouter de matières grasses : il vous suffit de bien attendre que la poêle soit très chaude (comptez 2 minutes) avant d’ajouter vos aliments en cuisson ! Parfait pour une cuisine la plus saine possible 🙂
Concernant le troisième inconvénient, celui du prix : si l’investissement de départ vous paraît trop conséquent, vous pouvez faire le choix d’une poêle en fonte de seconde main. De plus, avantage non négligeable, le culottage sera déjà fait !
Attention, la fonte est un matériau qui craint l’humidité : on vous recommande donc d’essuyer vos ustensiles avec un torchon sec, rapidement après le lavage et d’éviter le lave-vaisselle. Le culottage offre aussi une couche protectrice contre l’humidité, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il faut enduire toute votre poêle ou casserole d’huile 🙂 Côté lavage, attendez que la poêle refroidisse après cuisson, avant de la laver à l’eau chaude uniquement : le liquide vaisselle viendrait en effet attaquer la couche protectrice. Vous pouvez ensuite ajouter une fine couche d’huile avec du papier absorbant, avant de ranger votre poêle.
Quid de la fonte émaillée ? La couche d’émail formée pour protéger le fond de la poêle peut contenir des métaux lourds, comme du cadmium, pouvant être relâchés en cours de cuisson. De plus, on ne connait pas toujours la composition de la fonte émaillée utilisée.
Inox et acier inoxydable
Si la fonte vous paraît trop lourde ou contraignante, vous pouvez aussi vous tourner vers les poêles en acier inoxydable (composé de fer, de nickel et de chrome), en privilégiant celles en inox 18/10. Elles sont généralement plus légères et faciles à manipuler et si elles sont bien entretenues, leur durée de vie est plutôt longue. Elles ne manquent donc pas d’ avantages !
L’inox 18/10 présente la meilleure qualité d’inox, qui sera plus durable et permettra une meilleure répartition de la chaleur : si toutefois votre budget est plus serré, vous pouvez vous tourner vers l’inox “classique”, en vérifiant bien qu’il n’y a pas de revêtement anti-adhésif sur votre future poêle.
Car en effet, là encore, contrairement aux poêles en Téflon, les aliments peuvent accrocher pendant la cuisson dans les poêles en acier. L’astuce est en fait de bien faire préchauffer votre poêle et de réaliser le test de la goutte d’eau : si elle « roulotte » à la surface de la poêle, elle est assez chaude et vous pouvez ajouter vos aliments, avec un petit peu de matière grasse si besoin !
Vous pouvez aussi culotter votre poêle en inox avant utilisation, mais cela paraît moins indispensable que pour la fonte. Si vous choisissez cette option, ne mettez pas votre casserole ou votre poêle en acier au four, mais faites la bien chauffer environ 15 minutes sur feu moyen-fort, après l’avoir enduite d’huile neutre (vous pouvez aussi choisir cette façon de faire pour la fonte). Là encore, n’hésitez pas à respecter les consignes de culottage données par votre fabricant !
Cuivre
Les poêles et casseroles en cuivre sont également généralement sans PFAS, et plaisent aux amateurs de cuisine dans leur utilisation quotidienne, car le cuivre est un matériau qui conduit très bien la chaleur. Elles sont aussi une durée de vie tout à fait convenable.
Attention toutefois à l’oxydation et à l’apparition de « vert-de-gris », qui est toxique : pour éviter cela, vous pouvez choisir un cuivre « étamé », avec un revêtement en étain ou en inox. Prenez garde également à l’humidité !

Les poêles et casseroles sans PFAS recommandées
Maintenant que vous avez les grands principes (et surtout l’un des critères majeurs : ne pas choisir des poêles en Téflon ou avec un revêtement adhésif quel qu’il soit, car tous les revêtements sont susceptibles de contenir des PFAS), on vous propose une liste des marques proposant des poêles en fonte ou en inox qui sont des options tout à fait safe !
Ikea : inox (ce n’est pas de l’inox 18/10 en revanche, donc sa durée de vie peut être réduite) ou fonte
De Buyer (poêles en inox, sauf les poêles avec un revêtement anti adhésif)
Warmcook (notamment la gamme Lodge pour la fonte et Ecovitam pour l’inox). Vous avez d’ailleurs droit à 10% de réduction sur votre commande avec le code EMANCIPEES !
Baumstal (inox 18/10 sans revêtement)
Cristel (celles en inox 18/10 sans revêtement)
Le Creuset (bien choisir les poêles en inox sans revêtement)
Mauviel (inox et fonte sans revêtement)
Gastrolux (revêtement naturel, “base de bio-minéraux, des sédiments marins minutieusement broyés et cuits au four à plus de 500 °C”).
Lagostina (bien choisir les poêles en inox sans revêtement)
Le Vitaliseur de Marion, en inox 18/10 et qui permet aussi une cuisine saine et une cuisson très douce préservant les vitamines et minéraux des légumes, par exemple.
Pour composer cette liste, nous avons réuni vos recommandations sur Instagram et creusé cette question des PFAS et autres substances douteuses pour chacune des marques citées. Au moindre doute sur les matériaux et/ou s’il n’y avait pas d’indication claire quant à la composition des revêtements, nous les avons écartées. On a préféré mettre à votre disposition une liste plus courte et pas forcément exhaustive, mais avec des recommandations vraiment safe !
Conseils bonus : on ne peut que vous conseiller de faire le choix d’ustensiles (les spatules, notamment) plutôt en bois ou en métal, car le silicone alimentaire n’est pas forcément toujours très sain. De la même manière, soyez attentive au choix des matières grasses utilisées, car certaines peuvent être problématiques quand elles sont chauffées, comme le beurre.

On espère que cet article vous aura permis d’y voir plus clair et vous aura donné toutes les clés pour bien choisir vos poêles au moment de votre achat ! Vous méritez de cuisiner sans risquer de vous empoisonner sur le long terme et de mettre à mal votre équilibre hormonal et votre fertilité 🙂
Pour résumer, les poêles en acier inoxydable (si possible plutôt en inox 18/10), en fonte et en cuivre sont OK, si elles n’ont pas de revêtement adhésif 🙂 Elles ont également une belle durée de vie, donc l’investissement est généralement amorti. En revanche, si vous avez le moindre doute et que la composition manque de détails essentiels, passez votre chemin !
Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et surtout, si vous avez des marques safe à nous recommander, l’espace commentaires est là pour ça !
Les sources complémentaires